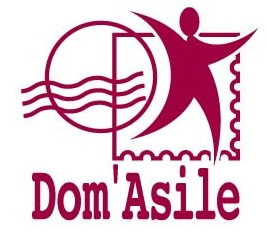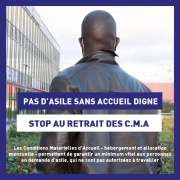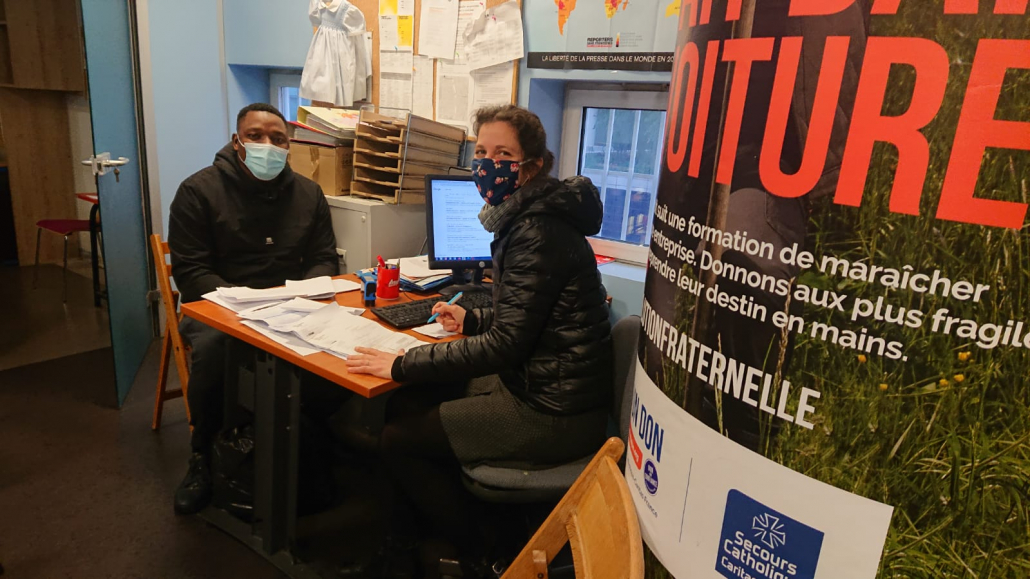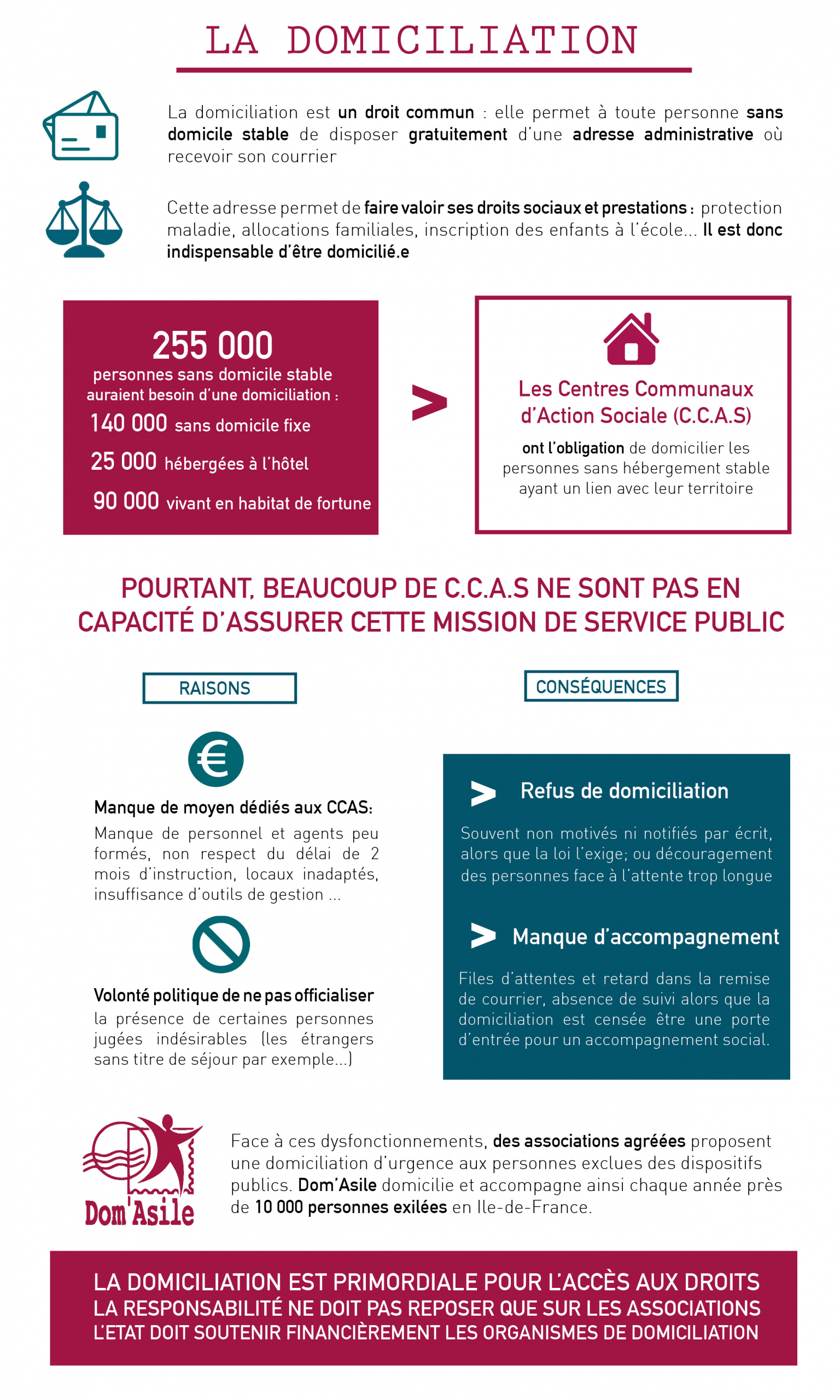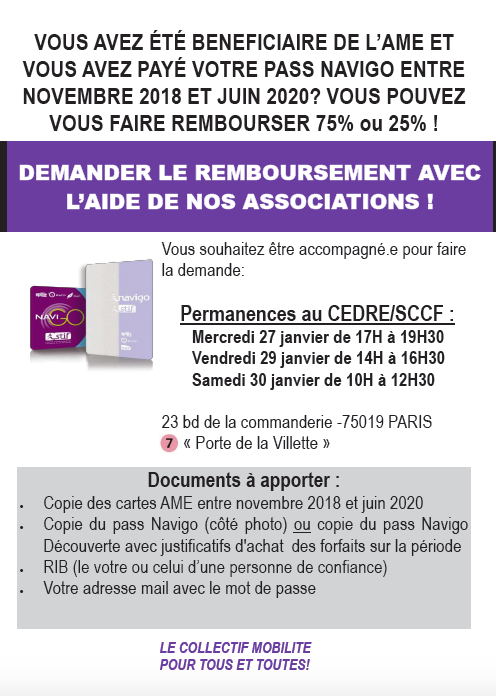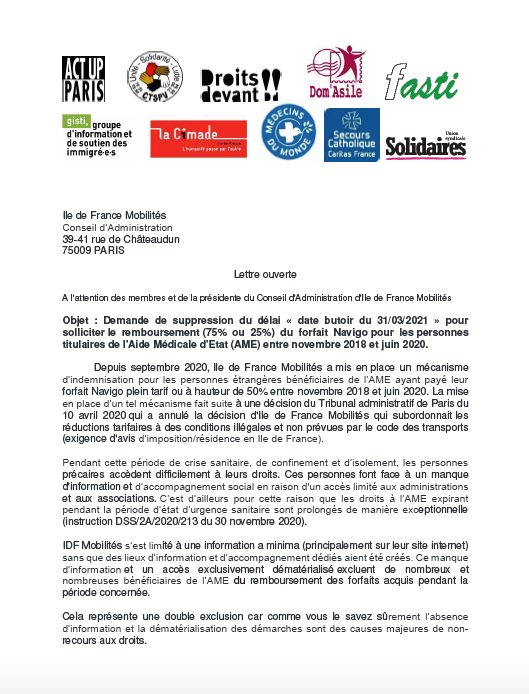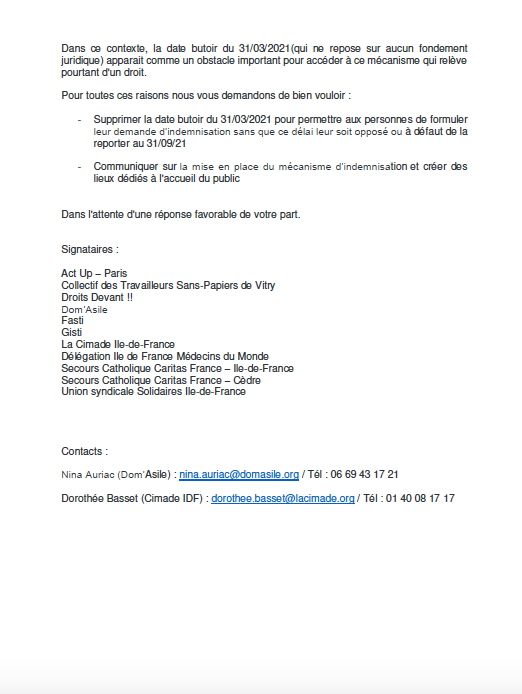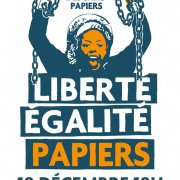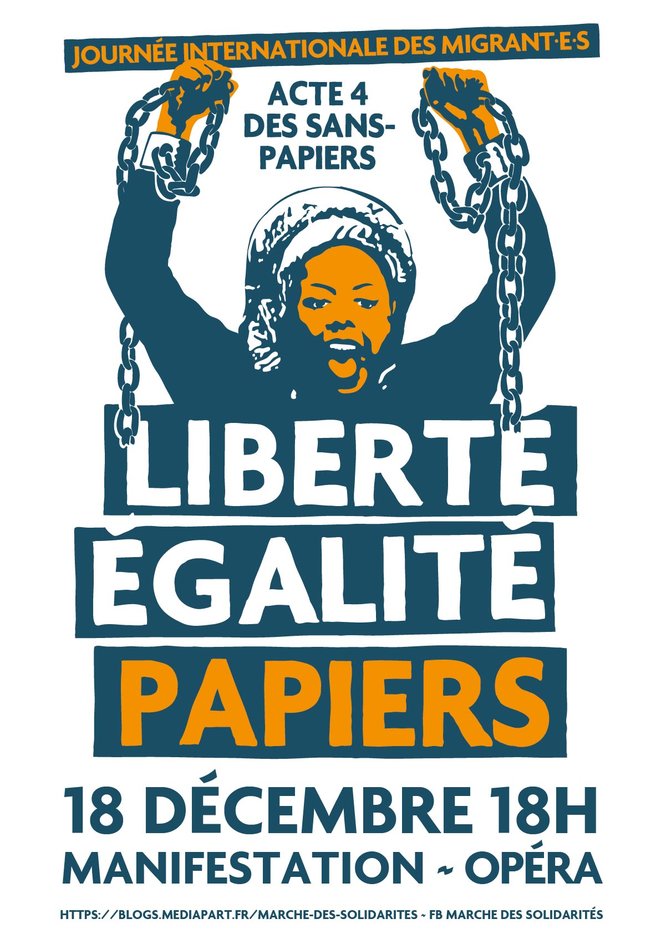Bannissement ! C’est le sort qui attend la vingtaine de jeunes majeurs à qui le préfet des Hauts de Seine a infligé une OQTF (Obligation de quitter le territoire français), assortie d’une d’interdiction de retour sur le territoire français. C’est voir, à 18 ans, leur parcours brutalement interrompu, leur avenir brisé, des efforts et des rêves fracassés. Il arrive que les tribunaux donnent tort à la préfecture. Cela ne suffit pas. Pour que ces jeunes majeurs puissent poursuivre leur formation et leurs apprentissages, signons massivement la lettre au Préfet du 92.
Ecoutez et faites partager aussi leur désespoir et leur colère, dans le clip « A quoi ça sert »
https://reseau-resf.fr/Slam-A-quoi-ca-sert
Monsieur le Préfet,
Vous avez entre les mains les dossiers des jeunes auxquels vos services ont délivré des OQTF au cours de ces derniers mois.
Mohamed Ba (élève de 2ème année de CAP Employé de vente), Alhassane Bah (apprenti cuisinier), Ousmane Bah (apprenti agent de maintenance à la SNCF), Abdoulaye Yacouba Camara (apprenti peintre en bâtiment), Arouna Camara (menuisier qu’un employeur a recruté), Taty Cissé (apprenti boulanger), Ahmadou Chérif Diallo (apprenti boucher), Samassa Diallo (apprenti boulanger), Saliou Balla Diallo (apprenti agent logistique), Souleymane Diallo (apprenti pâtissier), Katchienedjo Mohamed Diarra (apprenti agent logistique), Oumar Diawara (apprenti), Samba Gackou (apprenti boulanger), Moctar Kaba (apprenti boulanger), Ismaël Konaté (apprenti cuisinier), Mame Ass Mboup (qui doit signer un contrat d’apprentissage dans quelques jours), Amadou Sangaré (apprenti plombier), Chafia Bouallak (élève de bac pro Vente du lycée de Prony, Asnières-sur-Seine), Drissa Sidibé (apprenti pâtissier)
Derrière les jugements de placement à l’ASE, les contrats d’apprentissage, les bulletins de salaire, les actes d’état-civil, les bulletins scolaires, qui constituent les dossiers que vous examinez, ce sont des vies.
Dans la grande majorité des cas, celles de très jeunes gens, qui, à 15, 16 ou 17 ans, ont dû quitter et même fuir, seuls, leur pays, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, la Guinée…
Survivants d’un « voyage » où ils ont croisé la violence et la mort, celle de plusieurs de leurs camarades d’infortune, ils se sont montrés courageux, malgré les traumas qu’ils peinent encore à surmonter, et particulièrement motivés pour réussir leur scolarité et leur parcours de formation, encouragés et appréciés par leurs camarades, leurs professeurs, leurs formateurs et leurs maîtres de stage. Ils ont trouvé un employeur prêt à les embaucher, avec lequel ils ont signé un contrat d’apprentissage ou un contrat de travail. Ou sont sur le point d’y parvenir.
Tous ont déposé une demande de titre de séjour à la préfecture de Nanterre. Tous, depuis octobre 2020, ont reçu une obligation de quitter le territoire français (OQTF) assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF). Une mesure d’une extrême violence : notre pays, où ils vivent et se forment depuis quelques années, leur serait-il définitivement interdit ?
Pour chacun, des recours gracieux vous ont été adressés. Des mois ont passé, leur situation a fait l’objet d’articles de presse, des élus vous ont interpellé pour vous demander de leur accorder un titre de séjour avec autorisation de travail. Ceci leur permettrait de poursuivre leur parcours et d’accéder à une vie autonome et digne, grâce à leur emploi.
Deux mois après que vos services ont pris l’engagement que les situations seraient réexaminées avec bienveillance, deux jeunes, seulement, ont vu leur recours gracieux accepté. Mais les autres ? Et ceux qui depuis ont reçu à leur tour une OQTF ?
Monsieur le Préfet, nous persistons à demander que cessent ces décisions qui brisent la vie de ces très jeunes hommes et femmes, à exiger leur régularisation qui leur permettra d’occuper en toute légalité la place que, par leur travail, ils ont déjà dans notre société.
En cette période de crise, toute la jeunesse de ce pays est fragilisée et aucune catégorie ne peut compter moins qu’une autre :
— au nom du droit à l’éducation, l’école de la République a formé ces jeunes. Des professeurs, des formateurs se sont investis pour remplir leurs missions, et même au-delà. Les jeunes reconnaissent que sans leur soutien, ils n’auraient pas tenu. Notre pays a investi dans leur formation pour qu’ils deviennent boulanger, maçon, charpentier, cuisinier, couvreur, plombier, peintre… Ce sont des secteurs d’activité où les artisans rencontrent des difficultés à recruter et ils en témoignent en signant des attestations qui figurent dans les dossiers des jeunes.
— les motifs des OQTF prises par vos services s’appuient sur des éléments très contestables : des absences en faible nombre et qui ne peuvent légitimement pas être interprétées comme un manque de sérieux, des considérations sur les capacités scolaires des jeunes en désaccord avec les avis des professeurs et formateurs, des retards pris dans les parcours de formation qui sont imputables à la crise sanitaire et aux périodes de confinement que nous avons connues et non à la volonté des jeunes.
— nous souscrivons aux propos de bon sens tenus par Mme la Ministre du travail qui a déclaré le 08/01/2021 : « Quand on accueille des mineurs non accompagnés qui s’engagent dans des formations, au bout de deux ans, si tout s’est bien passé, alors ils peuvent continuer à travailler en France ».
Nous persistons à demander pour eux un titre de séjour avec droit au travail, parce que nous connaissons leur parcours et leur courage, parce qu’ils poursuivent actuellement tous, malgré vos décisions ou dans l’attente de la réponse de la préfecture, leur formation. Nous ne nous résignons pas à vous voir interrompre leur parcours avec brutalité, en décidant qu’ils doivent être expulsés.
Parmi ceux qui les connaissent, enseignants, employeurs, citoyens, personne ne peut imaginer qu’ils soient contraints de repartir dans leur pays, où la misère et le chaos continuent à régner. Nous ne cesserons donc de refuser leur expulsion.
Notre détermination à obtenir qu’ils puissent continuer à vivre ici, à étudier et à travailler dans les entreprises qui les ont recrutés, ne faillira pas. Bien au contraire, elle se renforce, nourrie par la solidarité qui nous anime.
Avec l’ensemble des associations de défense des droits, nous sommes déterminés à mener ce combat jusqu’à l’obtention par ces jeunes d’un titre de séjour avec droit au travail
Nous demandons que :
les jeunes qui poursuivent leurs formations professionnelles et/ou qui disposent d’un contrat (d’apprentissage ou de travail) puissent sereinement aller au bout de leurs formations et/ou s’insérer sur le marché du travail, voient leurs OQTF annulées ou leurs demandes aboutir favorablement, et donc obtiennent un titre de séjour protecteur et stable ;
cesse la suspicion généralisée qui pèse sur ces jeunes dont les actes d’état-civil sont encore et toujours contestés, alors que leur identité et leur âge ont été confirmés par des décisions du Juge des enfants et du Juge des tutelles, non contestées au moment de leur prise en charge par l’ASE ou confirmées par la cour d’appel, et par les autorités consulaires de leur pays d’origine ;
la procédure de dépôt des demandes de titres de séjour respecte les droits des jeunes majeurs, ce qui exclut les convocations forcées et implique que les jeunes qui ont passé leurs 18 ans et qui ne parviennent pas à obtenir une convocation soient reçus dans les meilleurs délais.
Nous comptons, Monsieur le Préfet, sur votre bienveillance et votre discernement et vous adressons l’assurance de notre détermination.